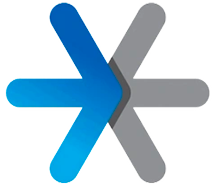Le dernier rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les dysfonctionnements majeurs du système de planification urbaine israélien. Entre rivalités institutionnelles, dispersion des responsabilités et déséquilibres territoriaux croissants, le modèle actuel favorise le développement non durable et accentue les inégalités socio-économiques, notamment entre le centre du pays et sa périphérie.
Ce texte analyse ces constats et propose les pistes essentielles pour une réforme profonde et cohérente.
Un système fragmenté aux intérêts divergents
Le rapport, fruit d’une étude rigoureuse menée par une équipe internationale d’experts, souligne que le système de planification en Israël est entravé par des intérêts contradictoires entre les différents ministères et agences gouvernementales.
Alors que le ministère du Logement se concentre principalement sur le développement du parc immobilier, le ministère des Finances gère la politique économique et le financement, tandis que l’Autorité des terres d’Israël (RMI) détient la responsabilité de l’allocation des terrains.
Cette multiplicité d’acteurs, sans coordination claire, crée ce que l’OCDE qualifie de « gouvernance fragmentée ». Chaque institution agit souvent de manière indépendante, au détriment d’une vision nationale cohérente et à long terme.
Si ce système permet parfois une réponse rapide à des besoins pressants, comme la croissance démographique, il nuit à une planification intégrée et stratégique, favorisant un développement désordonné.
Le renforcement du centre au détriment de la périphérie
Selon le rapport, la croissance démographique israélienne, qui a atteint 52 % depuis le début du XXIe siècle, est l’une des plus rapides des pays de l’OCDE. Toutefois, cette croissance s’est concentrée majoritairement dans la région métropolitaine de Tel Aviv, renforçant ainsi son rôle prépondérant.
Les zones périphériques, comme Haïfa ou Nazareth, ont connu un développement nettement plus lent, accentuant les disparités socio-économiques.
Les revenus des communes les plus aisées du centre dépassent trois fois ceux des régions les plus défavorisées, avec un accès aux services publics (écoles, hôpitaux) deux fois supérieur.
Ce déséquilibre territorial contribue à creuser les inégalités et fragilise la cohésion nationale.
La planification favorise les zones faciles à développer
Le rapport met également en lumière une tendance problématique : le système favorise la planification dans des zones où il est techniquement plus facile de construire, plutôt que là où la demande est la plus forte. Ainsi, la majeure partie des nouveaux permis de construire est délivrée à une distance de 10 à 30 kilomètres des centres urbains, dans des zones périphériques où la demande de logement est moindre.
Cette politique encourage la dispersion urbaine, avec la création de quartiers peu denses et éloignés, moins efficaces en termes d’infrastructures et de services, et moins favorables à la mobilité durable.
À l’inverse, les zones centrales, où la demande est plus élevée et où la densification urbaine pourrait être optimisée via la rénovation et la réhabilitation, bénéficient de peu de nouveaux permis.
Une commission aux pouvoirs démesurés : la WATMAL
Un autre point critique identifié est le rôle de la Commission pour la planification prioritaire des zones résidentielles (WATMAL), qui peut contourner les procédures de planification locales.
Cette instance, bien qu’efficace pour accélérer certains projets, agit souvent au détriment d’une planification intégrée et participative, et néglige les enjeux environnementaux et sociaux.
Cette déconnexion entre la planification accélérée et les réalités locales engendre un développement urbain désordonné, avec des coûts à long terme importants pour les infrastructures et l’environnement.
Vers une réforme ambitieuse et intégrée
Face à ces défis, l’OCDE formule plusieurs recommandations fortes :
– Instaurer des objectifs et principes nationaux juridiquement contraignants pour orienter le développement territorial ;
– Renforcer les pouvoirs de planification des autorités locales pour mieux adapter les projets aux besoins réels des territoires ;
– Promouvoir la coopération intercommunale afin d’optimiser l’utilisation des ressources et harmoniser les stratégies urbaines ;
– Intégrer systématiquement les principes du développement durable dans les processus de planification.
En réponse, le ministère israélien de la Planification a annoncé une réforme profonde, centrée autour d’une nouvelle « stratégie spatiale », visant à déplacer le paradigme actuel d’un modèle sectoriel vers une approche intégrée et collaborative.
L’objectif est d’équilibrer le développement entre le centre et la périphérie, d’améliorer la qualité de vie des habitants, et de réduire les inégalités territoriales.
Le rapport de l’OCDE dresse un tableau critique mais constructif du système de planification en Israël. La complexité institutionnelle et la dispersion des responsabilités freinent l’élaboration d’une vision spatiale claire et cohérente.
Le renforcement disproportionné du centre et la priorité donnée aux zones faciles à développer contribuent à aggraver les inégalités socio-économiques et à compromettre la durabilité urbaine.
La réforme engagée, si elle est menée avec rigueur et concertation, pourrait transformer profondément la gestion du territoire israélien, en plaçant l’équilibre, la durabilité et l’inclusion au cœur des choix d’aménagement.
Cette transition sera cruciale pour faire face aux défis démographiques et sociaux qui s’annoncent dans les décennies à venir.