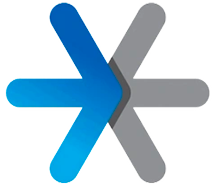Un arrêt de la Cour suprême d’Israël (Bagatz) a rejeté la demande de la Fédération nationale des entrepreneurs en bâtiment, qui sollicitait la reconnaissance de la guerre à Gaza comme cas de force majeure exonérant les promoteurs de leurs obligations contractuelles.
La décision ouvre la voie à de nombreuses actions en Justice de la part des acheteurs de logements en retard de livraison.
Contexte de l’affaire
Le Fédération des entrepreneurs avait saisi la Cour suprême pour que la guerre en cours à Gaza soit reconnue comme un «événement empêchant» (équivalent israélien du cas de force majeure).
Les promoteurs demandaient une exonération générale des sanctions prévues par la loi régissant la vente d’appartements (1973) en cas de retard de livraison.
Le Bagatz, sous la présidence de Yitzchak Amit, a rejeté cette demande, jugeant que la guerre ne constitue pas automatiquement un motif valable pour retarder la livraison des logements.
Les motivations juridiques de la décision
Limitation stricte de la notion de force majeure
La doctrine de la force majeure en droit israélien est appliquée de manière très restrictive : les tribunaux considèrent la guerre comme un risque prévisible, que les contractants devaient anticiper dans leurs accords.
L’article 18 de la Contracts Law (1970) exige que l’événement soit imprévisible, irrésistible et insurmontable — un seuil rarement atteint dans les litiges israéliens.
Le rôle limité du Bagatz
La Cour suprême a souligné qu’elle ne peut imposer à l’État d’élaborer une politique ou d’initier une loi visant à reconnaître officiellement la guerre comme événement mettant fin aux obligations contractuelles.
À ses yeux, la responsabilité politique et législative incombe au Parlement et au gouvernement, et non à la Justice.
Conséquences attendues
Flots de litiges jugés probables
À la suite de cette décision, des milliers de plaintes pourraient être déposées par des acheteurs de logements retardés.
Selon la Fédération, environ 110 000 acheteurs souffrent de retards dans la livraison de leur logement — un chiffre qui promet une surcharge judiciaire.
Position du secteur du bâtiment
Haim Feiglin, vice-président de la Fédération, estime que l’objectif était d’éviter des procédures longues et coûteuses.
Bien que la Cour n’ait pas donné gain de cause, elle n’a pas non plus rejeté les griefs de fond, ce qui pourrait encourager une future nouvelle saisine.
Point de vue des experts juridiques
Hadas Krispi, avocate spécialisée, soutient que les promoteurs utilisent à tort la guerre comme excuse : «la guerre… n’est qu’un prétexte de plus, alors que les promoteurs accusent systématiquement des retards de livraison».
Elle souligne l’inégalité structurelle entre acheteurs et promoteurs, protégée par la loi sur la vente (Mekhir).
Perspectives complémentaires
Impact économique global
Selon des estimations du bureau central des statistiques, le secteur de la construction a subi des pertes avoisinant les 98 milliards de shekels en 2024, soit 4,9 % du PIB, principalement attribuées à la guerre.
Le retard moyen de livraison est estimé à environ six mois, ce qui accentue le risque de litiges.
Risques pour les acheteurs et promoteurs
Comme sous la crise du COVID-19, de plus en plus d’acheteurs intentent des actions en Justice, ce qui peut faire chuter les liquidités des promoteurs et déstabiliser le marché immobilier.
Certains avocats alertent sur le risque systémique : effondrement des promoteurs, retards prolongés, charges financières pour les acheteurs toujours locataires.
Leçons juridiques : la force majeure n’est pas automatique
La jurisprudence israélienne est claire : la guerre n’est pas considérée comme force majeure sauf circonstances exceptionnelles et prouvées.
Les tribunaux exigent des preuves concrètes pour accepter l’exemption, au cas par cas, ce qui a été fatal aux entrepreneurs dans cette affaire.
Cette décision du Bagatz marque un tournant judiciaire : les promoteurs ne peuvent plus invoquer automatiquement la guerre comme justification pour retarder la livraison des logements.
Les litiges vont se multiplier, obligeant les tribunaux à analyser minutieusement chaque contrat et les preuves présentées. À terme, le législateur devra peut-être envisager une réponse structurelle pour encadrer ces situations exceptionnelles et protéger acheteurs et promoteurs.